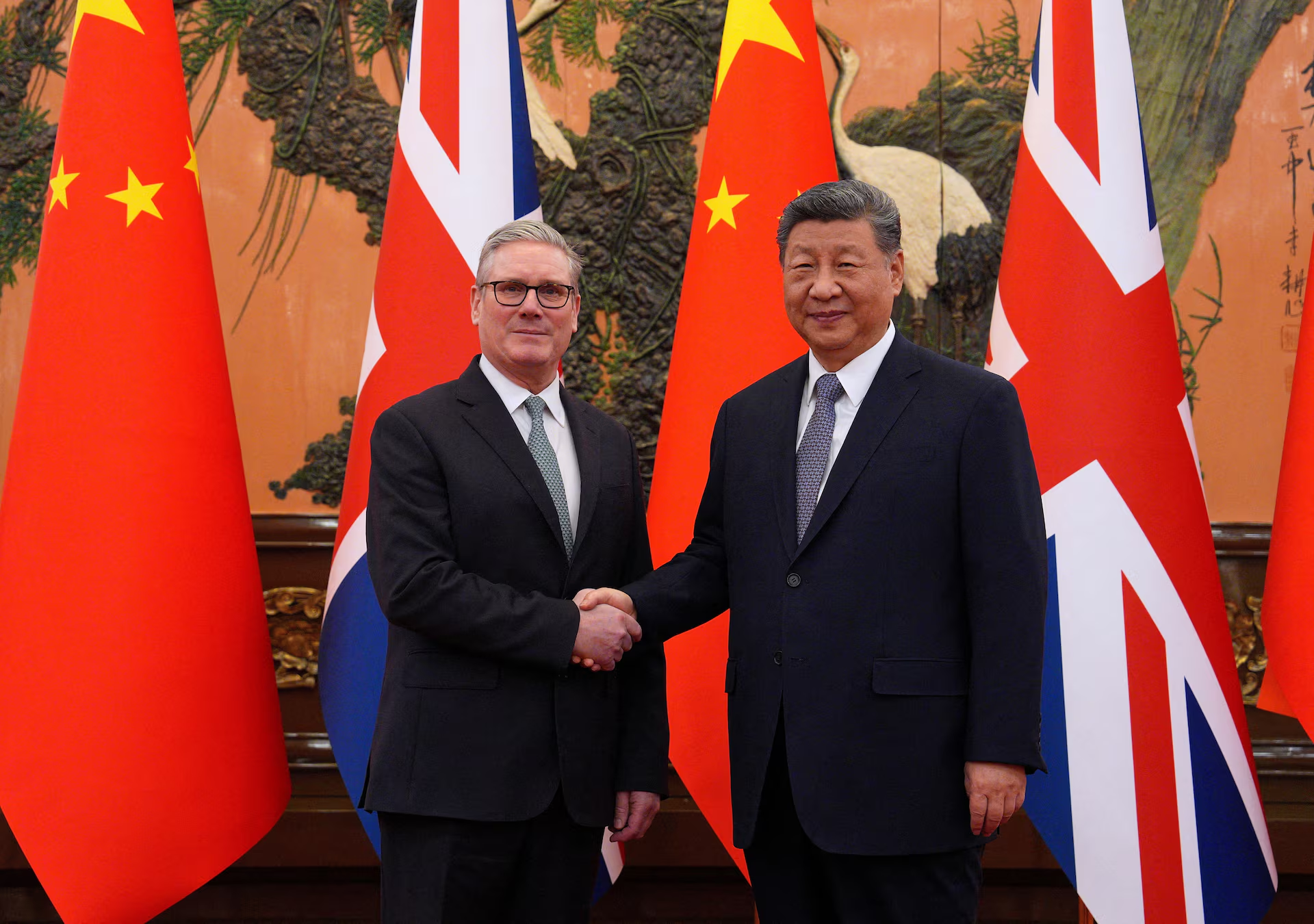La saisie du tanker Skipper illustre une relation Washington–Caracas désormais pilotée par les licences de l’OFAC, levier de pression réversible au cœur des sanctions pétrolières.
États-Unis–Venezuela : la diplomatie est-elle sous licence de l’or noir ?

À Washington, la relation avec Caracas ne se lit plus seulement dans le langage classique des sommets, des communiqués ou des canaux discrets. Elle se lit dans un autre registre, juridico-administratif, où chaque inflexion politique se traduit par un instrument concret et immédiatement mesurable : une autorisation, une exception, une fenêtre de temps, parfois un retrait brutal. Dans le cas vénézuélien, cette grammaire prend un nom technique devenu central, la « licence » délivrée ou retirée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). C’est là que se matérialise, au quotidien, l’articulation entre coercition et dialogue. La question n’est donc pas seulement de savoir si le pétrole pèse sur la diplomatie, mais de comprendre si, dans le cas États-Unis–Venezuela, la diplomatie est devenue un mécanisme conditionnel dont la clé d’accès, la cadence et le prix s’appellent pétrole, sanctions et licences.
La saisie, annoncée le 10 décembre 2025, d’un pétrolier lié au Venezuela par des services américains au large des côtes vénézuéliennes a brutalement rappelé que la « licence » n’est pas seulement un texte de conformité : elle s’adosse désormais à une capacité d’enforcement physique. Selon Reuters, le navire (le Skipper) a été saisi dans un contexte de durcissement et Caracas a dénoncé un acte de « piraterie », tandis que Washington a justifié l’opération au titre de la mise en œuvre des sanctions et de la lutte contre des réseaux de contournement. Dans cette séquence, la diplomatie n’est pas suspendue, mais elle est reconfigurée. Le dialogue, les signaux et les menaces passent autant par les annexes d’OFAC que par la matérialité d’un navire dérouté.
Cette architecture s’inscrit dans un contexte énergétique paradoxal. En effet, le Venezuela demeure, sur le papier, une puissance de réserves et un producteur capable d’influer sur des équilibres régionaux, mais ses capacités réelles ont été durablement érodées par la désorganisation de PDVSA, le sous-investissement et l’isolement financier. L’Energy Information Administration (EIA) rappelle l’ampleur des réserves prouvées, tout en soulignant la faiblesse relative de la production et l’état dégradé de l’appareil pétrolier.
Un point mérite d’être cadré avec précision, car il structure la rhétorique autant que l’économie : l’ordre de grandeur des réserves vénézuéliennes est d’environ 303 milliards de barils de réserves prouvées. Ce volume place Caracas au premier rang mondial en réserves prouvées, mais il ne se convertit pas mécaniquement en puissance exportatrice, faute d’investissements, de dilution possible et de chaînes logistiques fluides sous sanctions.
À cette contrainte s’ajoute une caractéristique centrale du brut vénézuélien : sa lourdeur et sa teneur en soufre, qui rendent le raffinage plus complexe et plus coûteux, et imposent souvent un mélange avec des diluants ou l’accès à des raffineries adaptées. Ce détail technique explique pourquoi les flux pétroliers sont aussi une affaire de capacités industrielles et de géographie des raffineries — notamment sur la côte du Golfe — et pourquoi le commerce légal du brut vénézuélien dépend si directement des fenêtres d’autorisation et de transport.
La « licence » comme monnaie diplomatique
Le pivot de la mécanique américaine se situe dans la configuration des sanctions sur le secteur pétrolier, et notamment dans la désignation de PDVSA en 2019, qui a structuré un régime de restrictions sur les transactions et services liés au pétrole vénézuélien, tout en laissant à l’exécutif un levier d’ajustement fin via licences générales et spécifiques. Les textes et communiqués du Trésor américain explicitent cette logique, en liant les mesures au financement du régime et à l’évasion des sanctions, et en inscrivant PDVSA dans le périmètre des Executive Orders pertinents.
Dans ce système, la licence n’est pas un détail de conformité mais bien un instrument de politique étrangère, parce qu’elle permet simultanément trois choses. D’abord, calibrer la pression sans lever formellement la stratégie de sanctions. Ensuite, sélectionner les acteurs autorisés à opérer, donc organiser un quasi-monopole politique sur les flux légaux. Enfin, rendre la relation réversible, en créant des phases de « relief » et de « snapback » dont le calendrier devient un message diplomatique en soi.
De Chevron à la diplomatie conditionnelle
Le cas Chevron illustre la transformation de la relation bilatérale en diplomatie sous licence. En novembre 2022, la General License 41 autorise certaines transactions « ordinairement incidentes et nécessaires » liées aux coentreprises de Chevron au Venezuela. Ce retour encadré d’un acteur américain majeur a longtemps été lu comme une soupape pragmatique, permettant de stabiliser une partie de l’offre de bruts lourds et de maintenir un point d’appui américain dans un secteur devenu largement extraterritorialisé.
La dimension politique s’affirme lorsque l’autorisation devient conditionnelle à une séquence de négociation et à des exigences de gouvernance électorale. La diplomatie autour de l’accord de la Barbade, conclu entre gouvernement et opposition, a fourni le cadre politique rendant acceptable, à Washington, une phase d’assouplissement ciblé. International Crisis Group décrit cet accord comme une trajectoire potentielle vers un scrutin plus compétitif, mais intrinsèquement fragile, exposée au contournement et au « backsliding ».
La logique conditionnelle se lit aussi dans les décisions américaines de 2024 sur la General License 44. Le Département d’État annonce explicitement l’expiration de la licence autorisant des transactions liées aux opérations pétrolières et gazières, en l’adossant à la conditionnalité politique et au comportement des autorités vénézuéliennes. Les FAQs d’OFAC, publiées pour encadrer l’application, confirment le caractère temporaire et révocable de cette autorisation, et la manière dont elle couvrait, pendant sa fenêtre de validité, des opérations allant de la production à l’exportation, sous réserve de restrictions importantes.
Après l’élection présidentielle vénézuélienne de juillet 2024, contestée et suivie d’un durcissement répressif selon plusieurs observateurs, la licence redevient un outil de sanction politique. WOLA souligne que la dynamique post-électorale s’accompagne de changements significatifs dans le régime d’autorisations pétrolières, ce qui ancre l’idée que la « porte pétrole » est désormais l’un des principaux interrupteurs de la relation bilatérale.
L’année 2025 marque une inflexion plus brutale. En mars, l’OFAC remplace la General License 41 par une General License 41A, puis par une 41B, orientées vers la cessation progressive (wind down) des transactions précédemment permises, avec des échéances resserrées. Quelques semaines plus tard, la 41B remplace et supersède la 41A, confirmant la logique de retrait progressif et signalant que l’accès au pétrole vénézuélien redevient un champ de pression.
Dans ces conditions, Reuters décrit comme la fin ordonnée d’un cycle, imposant l’arrêt des exportations de Chevron dans le délai prévu, et soulignant l’impact potentiel sur les revenus en devises et la trajectoire de la production.
Le saut d’échelle : quand la pression devient extraterritoriale
La diplomatie sous licence change de dimension lorsqu’elle ne vise plus seulement Caracas, mais aussi les acheteurs et intermédiaires étrangers. Le 24 mars 2025, selon Reuters, la Maison-Blanche a annoncé un ordre présidentiel prévoyant la possibilité d’imposer un droit de douane de 25 % sur les importations en provenance de tout pays important du pétrole vénézuélien (directement ou indirectement). L’acte est remarquable car il transforme l’instrument « pétrole vénézuélien » en levier commercial secondaire, avec un effet dissuasif qui déborde le cadre bilatéral et touche la logistique, l’assurance, la conformité bancaire et la diplomatie économique des partenaires.
Dans les faits, Reuters rapporte que cette menace a conduit certains clients à suspendre des importations, et que le retrait ou la révision d’autorisations concernant des partenaires de PDVSA s’inscrit dans ce signal plus général de durcissement à Washington.
Cette extraterritorialité nourrit l’hypothèse centrale, c’est-à-dire la diplomatie devient « sous licence » non seulement parce que les flux autorisés dépendent d’un texte OFAC, mais parce que l’ordre juridique américain est mobilisé pour structurer les comportements économiques d’États tiers, rendant le pétrole vénézuélien coûteux non par son prix, mais par le risque politique attaché à sa traçabilité et à sa conformité.
L’économie politique de PDVSA et la rente comme nerf du régime
Pour comprendre pourquoi ce levier est si puissant, il faut revenir à la place de PDVSA et à la nature rentière de l’État vénézuélien. Le Council on Foreign Relations rappelle la vulnérabilité structurelle des « petrostates », où la concentration du pouvoir, la dépendance aux recettes fossiles et les phénomènes de type Dutch disease affaiblissent les autres secteurs et durcissent les luttes de pouvoir autour de la rente.
NRGI, dans son profil de PDVSA, insiste sur les enjeux de gouvernance, de transparence et de contrôle, et fournit un cadre utile pour lire la licence américaine comme une tentative de couper ou de canaliser des flux financiers dans un système où la séparation entre entreprise nationale, État et réseaux de pouvoir est structurellement problématique.
C’est ici que la « licence » devient une arme de précision puisqu’une autorisation bien calibrée peut maintenir une activité minimale, éviter un effondrement incontrôlé, ou favoriser un segment « supervisable » des exportations. Inversement, un retrait peut assécher des entrées de devises, accroître la dépendance à des circuits opaques, et pousser l’écosystème pétrolier vers des rabais, des intermédiaires et des flottes de contournement. La question de savoir si Washington obtient, en échange, des concessions politiques durables, est au cœur du débat sur l’efficacité des sanctions. CSIS souligne ainsi que les licences liées à l’accord de la Barbade ont pu fonctionner comme une bouffée financière, sans garantie que le régime respecte des engagements démocratiques sur le long terme.
Entre intérêt national et intérêts privés : Chevron, lobbying, conformité
L’autre pilier de la diplomatie sous licence est le rôle des entreprises, en premier lieu Chevron, qui se trouve au point de jonction entre intérêt énergétique, présence américaine, et risque de financer indirectement un pouvoir contesté. Dans son rapport annuel déposé à la SEC, Chevron mentionne explicitement l’obtention de la General License 41 en 2022 comme cadre permettant la reprise d’activité, ce qui constitue une source primaire majeure pour établir le lien entre décision américaine et activité corporate.
Dans le transcript officiel de la conférence de résultats du quatrième trimestre 2024, la question du Venezuela apparaît comme un sujet adressé aux investisseurs, confirmant que l’exposition au risque réglementaire et géopolitique fait partie intégrante de la communication financière de l’entreprise.
À ce niveau, la licence a deux fonctions simultanées. Elle autorise un acteur américain à opérer sous contrainte et donc à préserver un « stake » national dans une zone d’influence disputée. Mais elle crée aussi un espace où l’entreprise, en cherchant la prévisibilité, devient une partie prenante indirecte de la séquence diplomatique, car la survie de son périmètre opérationnel dépend d’arbitrages politiques à Washington. L’existence de démarches de lobbying sur les « Venezuela sanctions » est documentée par les formulaires publics déposés au titre du Lobbying Disclosure Act, où la thématique apparaît dans les sujets déclarés, ce qui offre une base factuelle pour investiguer les canaux d’influence et la structuration des préférences à Washington.
Les ONG, enfin, proposent un angle critique. En effet, Global Witness soutient que les opérations sous licence peuvent constituer une forme de soutien financier indirect à un régime répressif, tout en citant des montants et des estimations qui doivent être recoupés avec des données et documents primaires. L’intérêt journalistique de ces publications tient moins à leur verdict qu’à leur capacité à pointer des zones d’opacité, des circuits de paiement, et des questions de traçabilité qui, dans un système sous sanctions, sont précisément au cœur de l’enquête.
Droits humains : l’ombre portée de la conditionnalité
La diplomatie sous licence se veut souvent « conditionnelle », mais la conditionnalité ne se mesure pas seulement à l’organisation d’un scrutin. Elle se mesure aussi à la répression, au traitement de l’opposition, à la judiciarisation, et à la violence politique. Les documents de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits du Haut-Commissariat aux droits de l’homme décrivent des schémas de violations graves et alimentent, dans les capitales occidentales, l’argument selon lequel assouplir le levier pétrolier sans contreparties vérifiables revient à financer la coercition.
En décembre 2025, Reuters rapporte des conclusions onusiennes sur des crimes contre l’humanité et des violations systématiques attribuées à des forces de sécurité, ce qui contribue à re-politiser tout débat sur l’assouplissement des sanctions et à renforcer la logique « licence comme récompense ou punition ».
Décembre 2025 : de la licence à la saisie, l’enforcement comme message
La séquence la plus récente illustre l’évolution du rapport de force. Le 10 décembre 2025, les États-Unis annoncent la saisie d’un tanker au large du Venezuela, dans un contexte de durcissement, et Caracas dénonce un acte de « piraterie ». Reuters précise que la saisie du Skipper intervient dans une dynamique où la pression s’exerce désormais non seulement par le droit des sanctions, mais par des actions opérationnelles qui désorganisent les flux physiques.
Deux jours plus tard, Reuters décrit une chute marquée des exportations, la paralysie de navires au large, et souligne qu’au moment de la crispation, seul Chevron, bénéficiant d’une autorisation particulière, continue à expédier du brut depuis le Venezuela. Cette asymétrie est, en elle-même, une définition concrète de la « diplomatie sous licence » : l’accès au marché et la capacité d’exporter deviennent un privilège réglementaire qui dépend d’un arbitrage politique américain.
Dans la foulée, le Trésor américain annonce de nouvelles désignations visant des acteurs de l’évasion de sanctions dans le secteur pétrolier, incluant des entreprises maritimes, et réaffirme le diagnostic selon lequel ces flux financent le régime.
La saisie du Skipper est aussi un révélateur de la géopolitique très matérielle du baril. Selon plusieurs récits de presse, le navire transportait près de deux millions de barils et se trouvait sur une route caribéenne sensible, au croisement de la pression contre Caracas et des besoins énergétiques de partenaires comme Cuba. Que l’épisode soit lu comme une opération de police des sanctions ou comme une démonstration de force, il produit le même effet diplomatique immédiat : augmenter le risque logistique, accroître le coût d’assurance et resserrer l’espace des transactions « tolérables », donc rendre la licence encore plus centrale comme passeport de circulation.
Le même mouvement de « sécuritisation » se lit dans l’extension du vocabulaire antiterroriste à des réseaux criminels liés au Venezuela. En février 2025, une notice publiée au Federal Register a acté la désignation de Tren de Aragua comme organisation terroriste étrangère, et une autre notice a, en novembre 2025, désigné le Cartel de los Soles comme organisation terroriste étrangère, ce qui accroît fortement les outils juridiques de poursuite et de dissuasion. Des experts onusiens ont toutefois alerté, à l’automne 2025, sur les risques pour le droit à la vie et sur les dérives potentielles d’une lutte dite « narco terroriste » lorsqu’elle s’accompagne de recours à la force au-delà des standards du droit international. Dans le récit vénézuélien, cette bascule nourrit l’idée d’une pression ouverte ; dans la logique américaine, elle renforce l’arsenal qui encadre, surveille et punit les circuits pétroliers considérés comme illicites.
Enfin, l’événement ne se comprend pleinement qu’à l’échelle régionale, car le Venezuela n’est plus le seul récit pétrolier du nord de l’Amérique du Sud. Depuis 2015, le bloc Stabroek au large du Guyana, opéré par un consortium conduit par ExxonMobil aux côtés de Hess et de CNOOC, a accumulé des découvertes majeures pour un volume de ressources récupérables estimé à plus de 11 milliards de barils, transformant le Guyana en nouvel acteur pétrolier, porteur d’un brut plus léger et donc plus simple à raffiner que le brut vénézuélien. Cette montée en puissance alimente une rivalité énergétique et politique implicite : d’un côté, Caracas dépend de « licences » pour faire circuler son brut lourd ; de l’autre, Georgetown attire capitaux, sécurité maritime et partenariats industriels, sous l’ombre portée d’intérêts américains très visibles.
C’est dans ce contexte que la question de l’Esequibo prend une dimension stratégique. La revendication vénézuélienne sur l’Esequiba, ravivée et politiquement mise en scène depuis 2023, entre en collision frontale avec un Guyana devenu rentier en devenir. Or, Washington a multiplié les signaux de coopération sécuritaire avec Georgetown, tandis que l’activité militaire américaine dans le bassin caribéen s’intensifie et alimente, côté vénézuélien, une lecture de « containment » régional. Dans une région où la diplomatie est saturée de droit, de sanctions, de contrats et d’escortes maritimes, la rivalité de l’or noir ne se joue pas seulement sur les volumes, mais sur la protection des routes, la maîtrise du risque et la capacité à faire du territoire une plate-forme sûre pour les majors.
Alors, diplomatie sous licence ou diplomatie à l’ombre du pétrole ?
L’analyse conduit à une réponse nuancée, mais difficile à esquiver. Oui, la relation États-Unis–Venezuela fonctionne, de fait, selon une diplomatie sous licence, parce que l’instrument principal de modulation, de dialogue et de punition n’est pas l’ambassade ou le traité, mais la permission d’opérer, d’exporter, de payer, d’assurer et de transporter, permission qui se donne et se retire par textes OFAC et actes présidentiels.
Mais cette diplomatie a ses contradictions structurelles. D’un côté, elle offre à Washington une flexibilité précieuse, une capacité à calibrer la pression et à ménager des canaux économiques « supervisables ». De l’autre, elle pousse une part croissante du commerce vénézuélien vers des circuits opaques, renforce le rôle de flottes et d’intermédiaires, et internationalise le coût politique du pétrole vénézuélien via des mesures secondaires, au risque de déplacer le problème plutôt que de le résoudre.
L’enjeu final est celui de l’efficacité et de la crédibilité. Brookings pose la question plus large d’une possible saturation de l’outil sanctions, lorsque l’instrument se multiplie, se complexifie, et finit par produire des effets non intentionnels ou des contournements massifs. Dans le cas vénézuélien, la multiplication des fenêtres de licences, puis leur retrait, puis l’escalade vers des tarifs secondaires et des saisies maritimes, dessine une politique où la diplomatie ne disparaît pas, mais se trouve enchâssée dans un dispositif juridique et économique qui transforme chaque baril en message politique.
Au fond, la question n’est peut-être pas de savoir si la diplomatie est « achetée » par l’or noir, mais si l’or noir est devenu le langage concret dans lequel la diplomatie s’écrit, s’évalue et se sanctionne. Le Venezuela, petrostate fragilisé, PDVSA structurellement opaque, et un marché pétrolier où la logistique compte autant que la géologie, constituent un terrain idéal pour cette diplomatie d’autorisations. Tant que les contreparties politiques resteront difficiles à vérifier et que la rente demeurera la colonne vertébrale du pouvoir, le dialogue Washington–Caracas continuera de se jouer moins dans les salles de négociation que dans les annexes des licences, les dates d’expiration, et la capacité très matérielle de faire sortir un cargo du Golfe du Venezuela.
Daily Bulletin Newsletter
Expert picks and exclusive deals, in your inbox