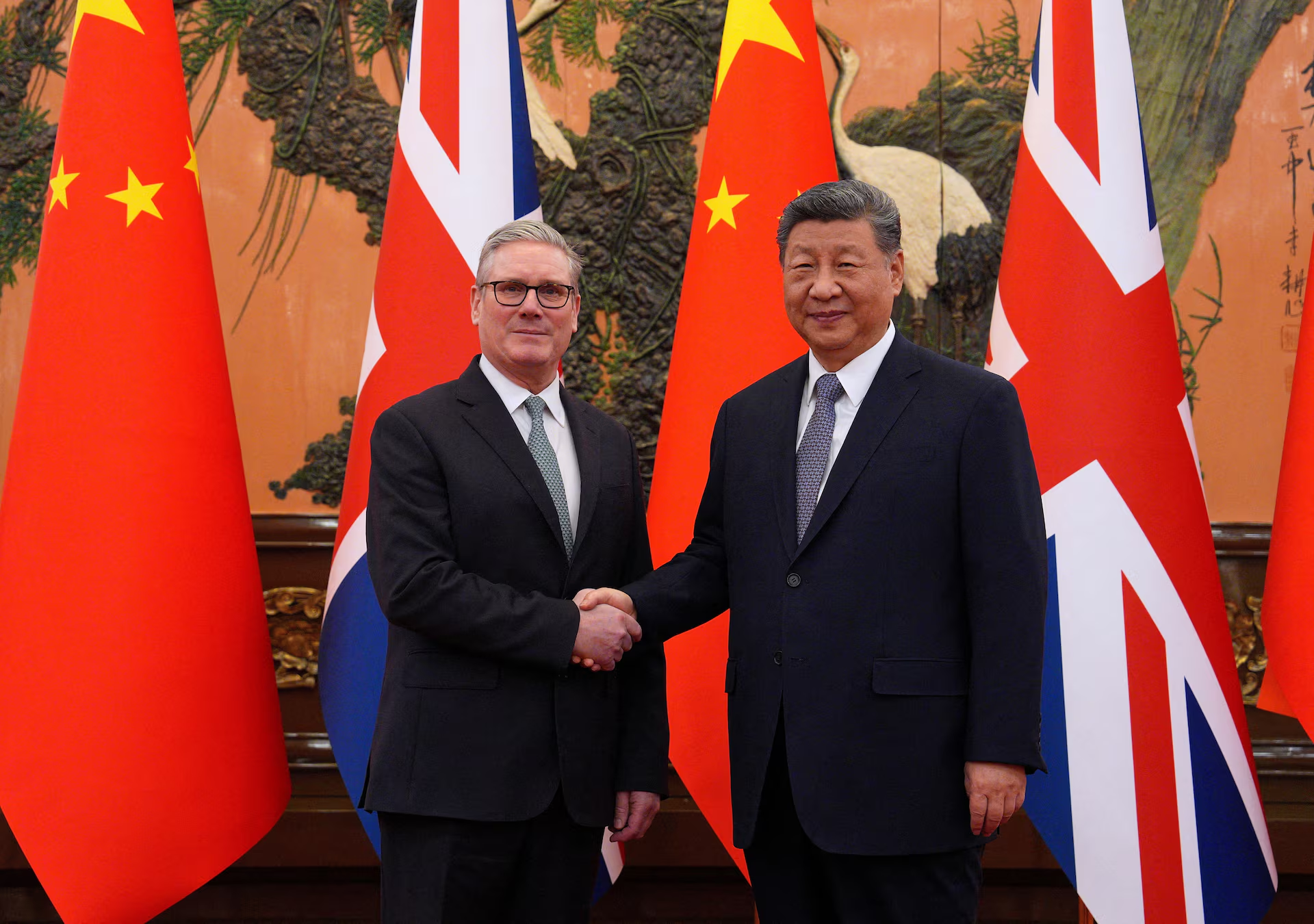De l’alliance défensive née de la guerre froide à l’outil de gestion de crises, l’OTAN redéfinit sa doctrine, élargissements et ses rapports conflictuels avec Moscou.
L’OTAN depuis la fin de la guerre froide

L’OTAN est née de la guerre froide et pour la guerre froide, mais elle a survécu à la fin de celle-ci, ce qui l’a contrainte à redéfinir son rôle. En avril 1949, elle se présente comme une organisation de défense collective à vocation essentiellement régionale, issue de l’Alliance atlantique et de la formation des blocs. Elle est toutefois progressivement devenue une organisation à vocation plus universelle, les États-Unis cherchant à en faire un instrument de sécurité collective placé sous leur contrôle politique et militaire.
Dans ce cadre, l’OTAN a été amenée à réviser en profondeur sa doctrine d’emploi. Son « concept stratégique » définit désormais les contextes dans lesquels elle peut être engagée ainsi que les missions qu’elle est appelée à prendre en charge.
L’OTAN peut-elle ne plus être une organisation de défense issue de la guerre froide ?
L’OTAN, une invention de la guerre froide – Il est important de rappeler que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), instituée le 4 avril 1949, procède directement du Traité de l’Atlantique Nord et, plus en amont, de la « grande alliance » occidentale forgée durant la Seconde Guerre mondiale. Sa naissance ne relève pas seulement de la continuité militaire de temps de guerre : elle s’inscrit dans la dynamique des premières crises de la guerre froide et dans la formalisation progressive de blocs politico-militaires structurés autour du plan Marshall (1947) et de la réponse soviétique de 1947-1948. L’accélération des traités bilatéraux conclus par l’URSS depuis 1943 (Tchécoslovaquie, puis en 1948 Hongrie, Roumanie, Bulgarie, etc.) consacre la cristallisation de deux ensembles antagonistes, dotés de cadres juridiques et sécuritaires distincts.
Le plan Marshall constitue l’un des principaux catalyseurs de cette bipolarisation. Présenté comme une offre ouverte de reconstruction économique et financière, y compris à destination de l’URSS et des démocraties populaires, il impose en réalité un choix stratégique : accepter une coopération étroite avec les États-Unis ou s’en exclure et assumer la logique de confrontation. Ni l’Allemagne ni l’URSS n’y sont initialement distinguées, mais les conditions de l’aide – coordination européenne sous égide américaine, transparence économique, intégration aux circuits du capitalisme atlantique – reviennent à subordonner l’entente intra-européenne à la primauté américaine. Les effets sont immédiats, à la fois sur le plan international (constitution d’alliances durables) et sur les scènes politiques internes, où les partis communistes européens quittent ou sont évincés des gouvernements. Se dessinent alors deux modèles de développement : d’un côté, une économie de marché libérale portée par la croissance américaine ; de l’autre, des économies planifiées fonctionnant en quasi-autarcie au sein du bloc de l’Est, dont les impasses structurelles contribueront à la crise puis à l’effondrement soviétique dans les années 1980.
Sur fond de désaccord radical sur la question allemande – enjeu central de sécurité pour les deux camps – la rupture géopolitique devient pleinement visible avec le blocus de Berlin (1948-1949) imposé par Moscou et le pont aérien organisé par les Alliés occidentaux (voir Cyril Buffet, La crise de Berlin, Fayard, 1994). Cet épisode, auquel le plan Marshall sert de toile de fond, consomme la division de l’Europe et prépare la formalisation de blocs antagonistes à trois niveaux : politique et idéologique (dissolution du Komintern en 1943, création du Kominform en 1947 et doctrine Jdanov), économique et, surtout, militaire. C’est dans ce contexte de durcissement stratégique que la création de l’OTAN, en 1949, prend tout son sens : elle constitue le volet militaire d’un dispositif occidental plus vaste, dont l’évolution, quatre décennies plus tard, conditionnera les recompositions de 1989.
Une fonction stratégique et militaire – Après le traité de Dunkerque conclu en 1947 entre la France et le Royaume-Uni, prolongé par le pacte de Bruxelles en 1948 avec les trois États du Benelux – matrice de ce qui deviendra l’Union de l’Europe occidentale (UEO) – se met en place un premier noyau européen de défense face à la montée des tensions Est-Ouest. C’est dans ce contexte qu’est signé, le 4 avril 1949, le traité de Washington instituant l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Douze États en sont membres fondateurs : la France, le Royaume-Uni, les trois pays du Benelux, le Canada, les États-Unis, l’Italie, le Danemark, la Norvège, l’Islande et le Portugal. Ils sont rejoints, en 1952, par la Grèce et la Turquie, puis en 1955 par la République fédérale d’Allemagne (RFA), consacrant progressivement l’OTAN comme pilier militaire de l’Ouest atlantique.
À l’origine, il s’agit d’une alliance défensive relativement souple, dépourvue d’automaticité mécanique dans la mise en œuvre de la clause de défense : l’article 5 prévoit qu’une attaque contre l’un des membres sera considérée comme une attaque contre tous, mais laisse à chaque État la décision des « mesures » jugées nécessaires. Cette flexibilité initiale est toutefois rapidement compensée par une intégration militaire croissante dans les années 1950. La mise en place de commandements intégrés, l’unification d’une partie de la planification stratégique et l’implantation de bases alliées – terrestres, aériennes et navales – sur le territoire de nombreux membres traduisent physiquement l’existence du bloc occidental (voir par exemple la représentation cartographique des deux blocs antagonistes chez Rageau et Chaliand, 1983). L’OTAN cesse ainsi d’être un simple traité d’assistance pour devenir une architecture de défense intégrée.
Cette consolidation suscite, en miroir, la réponse soviétique. Le 14 mai 1955, l’URSS propose la création du pacte de Varsovie, alliance militaire qui s’ajoute à un faisceau dense de traités bilatéraux déjà conclus avec ses voisins d’Europe de l’Est. Y prennent part l’URSS, l’Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République démocratique allemande (RDA), la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Se trouve ainsi formalisé le volet militaire du bloc socialiste, en stricte symétrie fonctionnelle avec l’OTAN : un système de défense collective, placé sous direction politico-militaire dominante de Moscou, destiné à encadrer les armées et les régimes d’Europe centrale et orientale.
Ce face-à-face militaire ne doit pas faire oublier une dimension souvent rappelée par les rédacteurs du traité de l’Atlantique Nord eux-mêmes : le texte réaffirme explicitement, dans son préambule, les principes de la Charte des Nations Unies, en particulier l’engagement à régler pacifiquement les différends internationaux. Les articles 5 et 6 encadrent la clause de défense dans un périmètre géographique précis (Europe et Amérique du Nord) et subordonnent les mesures prises par les alliés à l’information, voire à l’intervention du Conseil de sécurité. Dans l’esprit des dirigeants américains et de plusieurs gouvernements européens en 1949, l’OTAN n’est donc pas pensée comme une alternative à l’ONU, mais comme un dispositif régional de sécurité collective venant s’inscrire dans le cadre juridique onusien.
Très vite cependant, la logique des alliances régionales déborde l’espace euro-atlantique. La rivalité Est-Ouest se projette dans d’autres zones géopolitiques avec la création, en septembre 1954, de l’Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE), puis du pacte de Bagdad – futur CENTO – en 1955, associant la Turquie, l’Irak, le Royaume-Uni, le Pakistan et l’Iran. Parallèlement, la Chine populaire se rapproche de l’URSS pour quelques années, renforçant encore la cohérence stratégique du camp socialiste. Au milieu des années 1950, rares sont les États qui parviennent à se maintenir durablement en marge de cette structuration bipolaire, même si des politiques de non-alignement émergent progressivement en réaction à cette polarisation.
Dans ces conditions, l’équilibre international se trouve de plus en plus fondé sur des systèmes d’alliances blocs contre blocs, substitués dans les faits à l’ambition d’une sécurité collective universelle telle que portée par l’ONU en 1945. Entre 1949 et 1989, c’est ce face-à-face institutionnalisé – organisé par des traités, des doctrines stratégiques et des architectures de commandement intégrées – qui domine le régionalisme de sécurité. Reste alors à comprendre ce qu’il advient, après 1989, de cette configuration patiemment construite : comment une alliance née de la guerre froide se redéfinit-elle lorsque disparaît le cadre même qui en avait justifié la création ?
Les missions nouvelles après 1991 et les élargissements jusqu’en 2020
Pourquoi et comment garder l’OTAN après la fin de la guerre froide ? Pour la génération incarnée par George H. W. Bush, né après la Première Guerre mondiale et vice-président de Ronald Reagan pendant huit ans avant de lui succéder à la Maison-Blanche, il ne peut y avoir d’effacement du monde ancien. Dans cette lecture, les États-Unis ont « gagné » la guerre froide et entendent capitaliser sur cette victoire stratégique sans pour autant désarmer. Le discours, très en vogue au tournant des années 1990, d’un « nouvel ordre mondial » fondé sur le droit international et la sécurité collective ne se traduit donc pas par un véritable retrait militaire américain. Sous la présidence Clinton, Washington ne tire pas les « dividendes de la paix » que certains stratèges annonçaient : loin de réduire drastiquement leurs capacités, les États-Unis maintiennent un outil militaire de projection et cherchent surtout à cadrer l’après-URSS, notamment en préservant un dialogue stratégique bilatéral avec Moscou sur le contrôle des armements nucléaires hérités des républiques soviétiques. Les débats de 1991-1992 avec la Biélorussie, l’Ukraine et le Kazakhstan autour de la dénucléarisation et de la maîtrise des vecteurs stratégiques illustrent ce souci de stabiliser un espace post-soviétique devenu soudainement fragmenté.
Dans ce contexte, l’administration Clinton redéfinit le rôle de l’OTAN bien au-delà de sa fonction traditionnelle de défense collective territorialisée. L’Alliance est progressivement investie de nouvelles missions : maintien de la paix dans les Balkans, adaptation doctrinale à la « guerre contre le terrorisme », mise en place d’un « dialogue méditerranéen » à partir de 1994 afin d’accompagner – et souvent de canaliser – les transformations politiques et militaires des États européens, puis, après 2000, d’États situés en dehors du périmètre euro-atlantique. L’OTAN devient ainsi un instrument privilégié de gestion de crises et de projection de stabilité, au service d’une vision occidentale de la sécurité, au moment même où les États-Unis sont tentés par une posture de plus en plus unilatérale.
Cette tentation unilatérale se manifeste dès les premiers temps de la présidence Clinton. Washington ne renonce pas à intervenir dans les affaires internationales : d’abord au Proche-Orient, en soutenant le processus amorcé par la conférence de Madrid de 1991 et les accords d’Oslo à partir de 1993 sur la question israélo-palestinienne ; puis dans l’ex-Yougoslavie, après avoir laissé les Européens tenter – sans succès – de gérer seuls un conflit qui mêle guerre civile, éclatement étatique et épuration ethnique au cœur de l’Europe centrale à partir de 1992. À partir de 1994, et plus encore en 1995, la diplomatie américaine assume un interventionnisme « coercitif », c’est-à-dire adossé explicitement au recours à la force armée avec l’appui de l’OTAN. Les bombardements sur les positions serbes durant le siège de Sarajevo, ainsi que dans les Krajina, participent de cette logique d’emploi de la puissance aérienne pour peser sur le rapport de forces militaire autant que sur les négociations diplomatiques (voir notamment Jean-René Bachelet, Sarajevo 1995. Mission impossible, Riveneuve, 2016).
La stratégie américaine ne se limite pas à l’usage de la force : elle s’accompagne d’une intense pression diplomatique sur les dirigeants serbes de Bosnie et de Serbie afin de contraindre le régime de Slobodan Milošević à entrer dans un processus de négociation. Les accords de Dayton, négociés du 1ᵉʳ au 21 novembre 1995 sur la base américaine de Wright-Patterson (Dayton, Ohio), puis signés à Paris le 14 décembre 1995, entérinent une partition politique de la Bosnie-Herzégovine entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, tout en maintenant la fiction d’un État unique doté d’institutions communes. Sous l’égide du diplomate américain Richard Holbrooke (To End a War, Random House, 1998), le dispositif prévoit le déploiement d’une force multinationale de mise en œuvre, l’IFOR, puis de stabilisation, la SFOR, ainsi qu’un système de gouvernance tripartite laissant une large autonomie aux deux entités constitutives. La France, notamment après l’élection de Jacques Chirac en mai 1995, s’inscrit pleinement dans ce tournant, en soutenant l’option de fermeté et en participant à la Force de réaction rapide, au prix d’une réaffirmation de son engagement politico-militaire au sein de l’OTAN.
Sur le plan militaire, ces accords marquent un basculement majeur : l’IFOR, puis la SFOR à compter du 21 décembre 1996, sont des opérations menées sous commandement OTAN, succédant à la FORPRONU (1992-1995) placée sous égide onusienne. Avec les opérations Joint Guard (décembre 1996-juin 1998) puis Joint Forge (juin 1998-décembre 2004), l’Alliance assume des missions de maintien de la paix, de surveillance de la mise en œuvre des accords, de désarmement des forces en présence et de protection des autorités civiles soutenues par l’ONU. Parallèlement, les moyens de l’OTAN sont mobilisés pour rechercher et arrêter les responsables de crimes de guerre serbes recherchés par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, parmi lesquels Radovan Karadžić (arrêté en 2008) et Ratko Mladić (arrêté en 2011), même si ces interpellations interviennent bien après la fin des opérations de haute intensité.
L’engagement de l’OTAN en Afghanistan ouvre une nouvelle séquence. La Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS/ISAF), mandatée par le Conseil de sécurité de l’ONU à partir de la résolution 1386 du 20 décembre 2001, se distingue de l’opération Enduring Freedom, conduite sous commandement exclusivement américain. Basée initialement à Kaboul avant de s’étendre au reste du territoire, la FIAS est chargée d’aider le gouvernement afghan à rétablir la sécurité, à asseoir son autorité et à engager la reconstruction du pays. Forte de plus de 50 000 militaires en 2008, puis d’environ 150 000 soldats à son apogée en 2011, cette force placée sous un commandement militaire américain unique à partir de 2007 (généraux McChrystal, puis Petraeus) intègre des contingents issus de 51 pays, dont huit non membres de l’Alliance. Ses objectifs affichés sont multiples : protection des populations, renforcement des capacités nationales afghanes, lutte contre l’insurrection talibane, appui à l’État central et soutien à la reconstruction économique.
Le bilan, au moment du retrait de la FIAS le 28 décembre 2014, apparaît profondément ambivalent : environ 5 000 militaires tués en treize ans de guerre, des dizaines de milliers de morts civils, des pertes massives dans les rangs talibans, et un coût estimé à quelque 3 000 milliards de dollars pour les États-Unis et leurs alliés. La mort d’Oussama Ben Laden au Pakistan, à Abbottabad, en mai 2011, constitue certes un succès symbolique majeur pour Washington, mais ne stabilise en rien durablement le pays. La situation reste extrêmement fragile au début de l’année 2021, au moment où les États-Unis négocient le retrait de leurs forces et la réintégration des talibans au pouvoir, interrogeant, quarante ans après l’intervention soviétique de janvier 1979, la capacité des interventions internationales successives à transformer en profondeur les dynamiques politiques et sociales afghanes.
Paradoxalement, ces interventions – en ex-Yougoslavie comme en Afghanistan – n’ont pas entamé l’attrait de l’adhésion à l’OTAN dans l’espace euro-atlantique et au-delà. Après 1989, l’Alliance demeure perçue par de nombreux États comme une garantie de sécurité, mais aussi comme un vecteur d’intégration politique et militaire à « l’Occident ». C’est cette tension entre logique de puissance, rhétorique de sécurité collective, multiplication des opérations extérieures et persistance de la demande d’OTAN qui constitue l’un des principaux paradoxes de l’ordre international post-guerre froide.
Les élargissements de l’OTAN à de nouveaux Etats – Les élargissements successifs de l’OTAN constituent l’un des fils directeurs de la recomposition stratégique européenne depuis 1949. Si les premières adhésions s’inscrivent dans la logique classique de la guerre froide, les vagues postérieures à 1999 revêtent une signification radicalement différente, dans le contexte de sortie du bipolarisme et de redéfinition des rapports entre la Russie et l’Europe.
Dans un premier temps, l’histoire de l’Alliance est marquée par des élargissements limités mais structurants. La Grèce et la Turquie rejoignent l’OTAN en 1952 (premier élargissement), la République fédérale d’Allemagne (RFA) en mai 1955 (deuxième élargissement), l’Espagne en 1982 (troisième élargissement), alors même que des bases de l’OTAN sont déjà implantées sur son territoire depuis le milieu des années 1950 – notamment la base aéronavale de Rota, près de Cadix, puis la base de Morón de la Frontera, près de Séville, dans le cadre d’accords bilatéraux avec les États-Unis. Enfin, l’intégration de l’ex-RDA au sein de l’Allemagne unifiée, le 3 octobre 1990, entraîne mécaniquement son inclusion dans le dispositif atlantique (quatrième élargissement). Jusqu’au tournant des années 1990, ces élargissements restent insérés dans une logique occidentale de consolidation du front euro-atlantique face au bloc soviétique.
La fin de l’URSS, le 25 décembre 1991, change radicalement la donne. La disparition du Pacte de Varsovie et la création, le 8 décembre 1991, de la Communauté des États indépendants (CEI) par les accords de Minsk et d’Alma-Ata ne garantissent nullement à la Russie la préservation d’une « zone tampon » stratégique. Au contraire, en une dizaine d’années, une grande partie des anciens alliés de Moscou dans le bloc de l’Est se réorientent vers l’Union européenne, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’OTAN. Du point de vue russe, ce basculement est d’autant plus mal vécu qu’il est interprété comme la violation d’engagements politiques implicites : Mikhaïl Gorbatchev soutient dans ses mémoires que George H. W. Bush et Helmut Kohl lui auraient assuré que l’OTAN ne pousserait pas ses structures plus à l’est ; Boris Eltsine puis Vladimir Poutine feront de cette « promesse non tenue » un argument central de la critique du système de sécurité euro-atlantique (voir par exemple Françoise Thom, Comprendre le poutinisme, Desclée de Brouwer, 2018).
Côté centre-européen, la dynamique est inverse. Les États du groupe de Visegrád (Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie) affichent dès février 1991 leur volonté de s’arrimer à l’Ouest en visant une double intégration, vers l’Union européenne et vers l’OTAN. Ils engagent des réformes internes de leurs forces armées afin de se conformer aux standards opérationnels et doctrinaux de l’Alliance. Le sommet de l’OTAN de Rome, en novembre 1991, dessine le cadre politique de ce mouvement en mettant en avant un triptyque « économie de marché, démocratie, paix », appuyé sur de nouveaux instruments de coopération : Partenariat pour la Paix, Conseil de coopération nord-atlantique puis Conseil de l’Atlantique Nord. En Hongrie, un référendum organisé en 1997 entérine ce choix : 85 % des votants se déclarent favorables à l’adhésion. Au sommet de Madrid, la même année, la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie reçoivent une invitation formelle – la Slovaquie étant écartée en raison d’une dérive jugée antidémocratique. Leur adhésion est officiellement consacrée au sommet de Washington en 1999. Dans le même temps, d’autres États d’Europe médiane et balkanique manifestent leur intérêt, alors même que la Russie dénonce avec virulence l’action de l’OTAN, notamment lors de la guerre du Kosovo et des bombardements sur Belgrade au printemps 1999. Le remodelage de l’environnement stratégique de la Russie est lancé, et apparaît à Moscou comme un processus quasi inéluctable.
La grande bascule se produit avec ce que l’on peut qualifier de « cinquième élargissement historique » : le 29 mars 2004, sept nouveaux États rejoignent l’Alliance – Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Cet élargissement concentre plusieurs lignes de fracture. La Bulgarie est un ancien allié traditionnel de Moscou ; surtout, l’adhésion des trois États baltes cristallise les réticences russes, en raison de leur position stratégique sur la mer Baltique et de la proximité de l’enclave de Kaliningrad, fragment de l’ancienne Prusse orientale annexé par l’URSS en 1945. L’histoire douloureuse de ces territoires – annexions successives, occupations allemandes et soviétiques, déportations de masse de populations baltes en 1939-1941 puis à partir de 1944 – est désormais rappelée dans un cadre européen élargi (voir Frank Tétart, Géopolitique de Kaliningrad. Une “île” russe au sein de l’Union européenne élargie, PUPS, 2007). Pour Moscou, ce mouvement équivaut à un détachement accéléré de ce qu’elle perçoit comme son « étranger proche », et réécrit plusieurs siècles de relations et d’influences croisées entre la Russie et l’Europe occidentale.
Pour les États concernés, au contraire, cet élargissement fait figure de tournant historique : il est perçu comme un double « passeport » – pour la sécurité, par l’Alliance atlantique, et pour la prospérité, par le marché intérieur de l’Union européenne, dont l’élargissement de 2004 puis de 2007 parachève l’intégration de l’Europe centrale et orientale. À partir de ce moment, la Russie n’est plus seulement dans une posture de contestation discursive de l’OTAN ; elle adopte une véritable « politique d’arrêt », visant à fixer des lignes rouges à l’expansion atlantique, en particulier dans l’espace post-soviétique.
Les cas de la Géorgie et de l’Ukraine illustrent cette inflexion. À la suite de la « révolution des Roses » en 2003, la Géorgie se projette clairement vers une adhésion à l’OTAN. Un référendum organisé en janvier 2008 voit 77 % des électeurs se prononcer en faveur de cette perspective. En avril 2008, lors du sommet de Bucarest, l’OTAN accepte le principe d’une future adhésion de Tbilissi, en dépit de l’opposition russe. Quelques mois plus tard, en août 2008, éclate la deuxième guerre d’Ossétie du Sud, avec le déploiement de troupes russes bien au-delà des zones séparatistes. La crise géorgienne gèle le rapprochement entre Tbilissi et l’Alliance et manifeste la volonté de Moscou d’user de la force pour empêcher tout basculement de certains territoires qu’elle considère comme relevant de sa sphère d’influence. Malgré tout, l’OTAN maintient des perspectives d’adhésion pour quatre candidats – Géorgie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine et Monténégro – même si, en novembre 2011, Dmitri Medvedev affirme que la fermeté russe a contribué à enrayer la dynamique d’élargissement, l’Alliance cherchant à temporiser en 2014 face à la persistance de la demande géorgienne.
Les derniers élargissements formels – Albanie et Croatie en 2009, Monténégro en 2017, Macédoine du Nord en 2020 – apparaissent alors davantage comme l’achèvement d’un cycle que comme l’ouverture d’une nouvelle phase d’expansion. La Russie place au cœur de sa doctrine de sécurité l’impossibilité d’accepter une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. L’annexion de la Crimée en 2014, en violation du droit international, constitue un point de non-retour. La réponse occidentale est alors essentiellement politique et juridique : régimes d’embargos et de sanctions de l’Union européenne, mesures onusiennes, suspension de plusieurs cadres de coopération. Moscou, de son côté, assume le soutien aux mouvements séparatistes pro-russes dans le Donbass, pérennisant une situation de conflit gelé malgré les tentatives de médiation européennes (notamment franco-allemandes).
Dans ce contexte de tensions structurelles, des débats internes se ravivent dans plusieurs États restés à l’écart de l’Alliance : la Suède, la Finlande, mais aussi la Serbie, interrogent publiquement, chacune à leur manière, l’opportunité d’une adhésion à l’OTAN ou d’un rapprochement approfondi avec l’architecture euro-atlantique de sécurité. Ces discussions nationales témoignent d’un paradoxe déjà à l’œuvre depuis les années 1990 : plus la contestation de l’OTAN est forte du côté russe, plus l’Alliance continue d’exercer un pouvoir d’attraction durable sur des États qui y voient une garantie de sécurité face précisément à la pression de Moscou. C’est dans cette tension entre promesses initiales, ressentiment russe et demandes persistantes d’adhésion que se joue une large part de la crise du système de sécurité européen contemporain.
A nouveau contexte international, nouvelle OTAN ?
La tentative de « substitution » de l’OTAN au conseil de sécurité de l’ONU – La disparition du pacte de Varsovie en 1991, dissous dans le sillage de l’effondrement de l’URSS, a créé une asymétrie structurelle durable dans l’architecture de sécurité européenne. Alors que l’Alliance atlantique survit à la guerre froide et se réinvente, son pendant oriental disparaît sans qu’aucune structure collective de défense – y compris la Communauté des États indépendants (CEI), fondée en 1991 – ne vienne véritablement s’y substituer. Dans cet espace post-bipolaire, l’OTAN apparaît de plus en plus comme l’instrument privilégié de la projection de puissance des États-Unis et de leurs alliés, en particulier lorsque le veto potentiel de la Russie ou de la Chine au Conseil de sécurité rend incertain le recours classique au cadre onusien. Dans le sillage de la résolution « Acheson » de 1950 – qui légitime, en contexte de paralysie du Conseil de sécurité, des formes alternatives d’action collective – se met en place une pratique où la rhétorique de la « sécurité collective » sert souvent de justification à des opérations menées en marge, voire en amont, des procédures institutionnelles prévues par la Charte des Nations Unies.
Cette évolution se déploie en trois temps. Dans une première phase, au début des années 1990, l’OTAN s’efforce de se présenter comme le bras armé de l’ONU, agissant en théorie sous le contrôle politique de celle-ci. C’est le modèle expérimenté dans l’ex-Yougoslavie : la FORPRONU, force de protection des Nations Unies, est déployée au sol, tandis que l’Alliance fournit, par des campagnes de frappes aériennes, un appui coercitif destiné à peser sur les belligérants. Juridiquement, les opérations s’inscrivent dans un cadre onusien ; politiquement, elles manifestent déjà une double hiérarchie, où la légitimité formelle est fournie par le Conseil de sécurité, mais où la planification, les règles d’engagement et la conduite opérationnelle relèvent essentiellement des structures politico-militaires de l’OTAN.
La seconde étape est inaugurée avec les accords de Dayton de novembre 1995, négociés en dehors du cadre onusien, sous conduite diplomatique américaine. Une fois la solution politique définie sur la base aérienne américaine de Dayton, le Conseil de sécurité est appelé à entériner ex post un dispositif dans lequel l’OTAN se voit confier un rôle central : l’IFOR (Implementation Force), puis la SFOR (Stabilization Force), agissent sur mandat de l’ONU mais sous commandement intégralement OTAN. L’Alliance, déjà sortie de sa logique strictement territoriale, devient un gestionnaire de la paix armée, chargé d’imposer sur le terrain les termes d’un compromis négocié hors des enceintes onusiennes. Ce modèle est ensuite prolongé et amplifié en Afghanistan, où, à partir de 2003, l’OTAN prend le relais de la direction de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), là encore dans le cadre d’un mandat du Conseil de sécurité, mais avec une architecture politico-militaire dominée par Washington et ses principaux alliés.
La troisième phase, inaugurée par la crise du Kosovo en 1999, marque un saut qualitatif. Le territoire kosovar, cœur symbolique de la Serbie médiévale et lieu de la « grande migration » de 1690 vers le nord des populations serbes (comme le rappelle Olivier Chaline), occupe une place centrale dans l’imaginaire national serbe. En 1999, l’OTAN décide de lancer une campagne de bombardements contre les forces serbes et des frappes sur Belgrade sans disposer d’une résolution explicite du Conseil de sécurité autorisant le recours à la force. L’Alliance assume alors directement la direction politique et militaire de l’opération, en construisant a posteriori une argumentation juridique fondée sur l’interprétation extensive du traité de 1949 et l’invocation d’une « intervention humanitaire ». Cette lecture est vigoureusement contestée par les membres permanents du Conseil de sécurité qui ne sont pas membres de l’OTAN, en premier lieu la Russie et la Chine, qui y voient une remise en cause de la centralité du Conseil dans la gestion de la paix et de la sécurité internationales.
La résolution 1244 du Conseil de sécurité, adoptée en juin 1999, entérine finalement une situation de fait : elle confie à la KFOR, force multinationale dirigée par l’OTAN, la responsabilité du maintien de la sécurité au Kosovo, en contrepartie de la présence symbolique d’un contingent russe au sein du dispositif, officiellement chargé de défendre les intérêts des populations serbes. La séquence kosovare révèle ainsi le cœur du paradoxe : derrière le vernis d’une action conduite « au service » de la sécurité collective et en articulation plus ou moins lâche avec l’ONU, ce sont bien les États – et d’abord les États-Unis – qui définissent les objectifs, les modalités et les limites de l’emploi de la force armée, en fonction de leurs intérêts nationaux jugés primordiaux. L’OTAN apparaît alors moins comme une simple organisation de sécurité régionale que comme l’une des formes institutionnelles de cette volonté étatique, capable de court-circuiter, lorsque cela est jugé nécessaire, les mécanismes de décision collective du système onusien.
L’OTAN au service de pratiques unilatérales américaines – En premier lieu, il faut souligner la volonté, du côté américain, de faire évoluer l’OTAN d’une alliance de défense régionale vers un véritable dispositif de sécurité collective à vocation quasi universelle. Dans la perspective de Washington, au tournant des années 1990, l’ONU apparaît de plus en plus comme un cadre contraignant, traversé par des logiques de veto et de blocages, peu compatible avec l’unilatéralisme assumé de la puissance américaine. L’Alliance atlantique est alors pensée comme un outil multilatéral « maîtrisé », susceptible de porter une conception particulière de l’ordre international : libérale, occidentale et hiérarchisée. D’où le grand débat, à partir de 1989, sur la transformation de l’OTAN : d’organisation régionale limitée à un nombre restreint de membres européens et nord-américains, elle tend à devenir un système de sécurité élargi, potentiellement ouvert à toujours plus d’États, jusqu’à se présenter comme un cadre presque universel. Dans cette configuration, l’OTAN constituerait le bras militaire d’un G8 essentiellement politique, tout en préemptant toute tentative autonome de construction d’une architecture européenne de sécurité. Une telle évolution, placée de facto sous leadership américain, ne pouvait qu’être inacceptable pour des puissances comme la France, la Russie ou la Chine, soucieuses de préserver soit leur autonomie stratégique, soit la centralité du Conseil de sécurité.
Lorsque cette stratégie de multilatéralisme encadré rencontre ses limites, les États-Unis recourent à d’autres modalités d’action. Ils n’hésitent pas à agir en dehors du mandat explicite de l’OTAN et du Conseil de sécurité, en bâtissant des coalitions ad hoc. Le cas de l’Irak, bombardé en 1998-1999 dans le contexte du blocage des inspections onusiennes sur les armes de destruction massive, illustre ce recours unilatéral à la force : Washington invoque la Charte des Nations Unies et des résolutions antérieures, mais s’affranchit d’une nouvelle autorisation du Conseil. Après les attentats du 11 septembre 2001, les alliés européens suggèrent de mobiliser l’article 5 et de placer la riposte sous parapluie OTAN ; les États-Unis préfèrent cependant conduire l’intervention contre le régime taliban en Afghanistan dans le cadre d’une coalition qu’ils contrôlent directement. En 2003, pour l’invasion de l’Irak, l’OTAN ne peut davantage être mobilisée comme substitut à l’absence de résolution autorisant explicitement le recours à la force : c’est là encore une « coalition de volontaires » qui est assemblée, marquant la tension permanente entre l’affichage multilatéral et la réalité d’une décision stratégique fondamentalement américaine.
Dans ce contexte, l’Alliance tente néanmoins de se redéfinir politiquement. Son secrétaire général – toujours issu d’un pays européen, tandis que le commandement militaire suprême est traditionnellement confié à un général américain – est, en 2010, le Danois Anders Fogh Rasmussen. Celui-ci plaide alors pour une OTAN ouverte à l’ensemble des États européens, y compris ceux de l’Est anciennement intégrés à l’orbite soviétique, et, à terme, à la Russie elle-même, dans une logique de « partenariat stratégique » et de concertation élargie. Il répond ainsi à la vision formulée par Barack Obama, tout juste élu en novembre 2008, et par sa secrétaire d’État Hillary Clinton : transformer l’Alliance en une « nouvelle organisation de coopération et de sécurité collective », rompant avec l’image de la « vieille OTAN » de la guerre froide et tendant la main à Moscou. Vladimir Poutine oppose à cette proposition un refus net, non sans une certaine ironie, y voyant moins une ouverture sincère qu’une tentative de neutraliser les marges de manœuvre russes au sein d’un dispositif toujours structuré par la supériorité américaine.
Cette déclaration de février 2010, relayée par Hillary Clinton à destination de la Russie, s’inscrit aussi dans une stratégie de communication visant à faire oublier la poussée américaine en direction de la Géorgie et de l’Ukraine depuis le sommet de Bucarest de 2008 et la guerre de l’été 2008 en Ossétie du Sud. Or, dans la représentation historique russe de la puissance, de l’espace et des frontières, l’idée même d’une intégration de ces deux États – en particulier de l’Ukraine, souvent présentée comme l’un des berceaux de la civilisation russe – dans le dispositif atlantique est perçue comme un casus belli stratégique. C’est précisément à ce point de friction, entre projet d’un OTAN élargie à vocation quasi universelle et perception russe d’un rétrécissement intolérable de sa profondeur historique et géopolitique, que se cristallisent nombre des tensions qui structurent aujourd’hui encore la crise du système de sécurité européen.
En définitive, la notion de sécurité collective a été repensée, sinon détournée par Washington sous la présidence de G. Bush junior. Elle est donc devenue un instrument de l’hégémonie individuelle des Etats-Unis selon Serge Sur (Relations internationales, 2006, p. 465). Cette évolution s’est parfois faite avec le concours d’alliés (anglais), mais toujours sous la direction politique et militaire des Etats-Unis. Si bien que l’OTAN est désormais perçue comme tant un outil privilégié de la politique étrangère américaine. Evolution du système de la charte ou abandon pratique de celle-ci, posant les termes de sécurité internationale en des logiques inédites.
Daily Bulletin Newsletter
Expert picks and exclusive deals, in your inbox